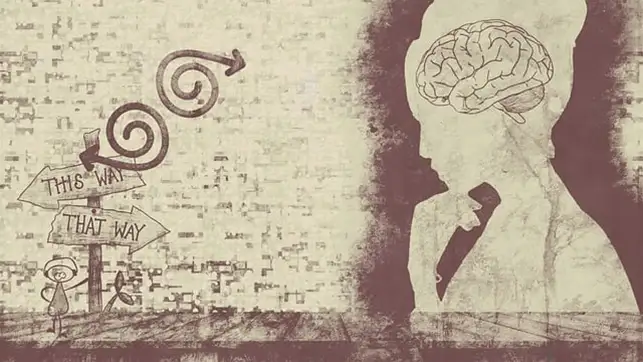
Introduction
Lorsque j’ai formellement occupé un poste de manager, entre 2004 et 2021, la fonction était déjà soumise à pression. Je me souviens des plans marketing demandés chaque année pour des prévisions à un an et plus, qui se sont suivis par des plans à six mois… pour arriver à plus de plans du tout, en tout cas au niveau du middle management auquel j’appartenais. Avec mes collègues, nous disions d’ailleurs que nous n’étions pas des «Madame Soleil» et que les perspectives du marché se bousculaient tellement qu’il était inutile de faire des plans sur la comète.
Quand la pandémie Covid-19 a été déclarée en Europe en mars 2020, sur un fond général de panique et de peur relayé à grands renforts par les médias, les activités se sont trouvées à l’arrêt, avec une partie des employés au chômage économique partiel ou total, quelle que soit la fonction exercée.
Dans ce climat délétère commence aussi le télétravail, qui ne faisait pas partie de la culture d’entreprise en Europe francophone jusque-là. Il s’agissait d’une nouvelle manière de communiquer et d’interagir avec les équipes. Pour toutes les personnes concernées, entre celles qui devaient ouvrir leur ordinateur dans des pièces inadaptées car n’ayant pas de bureau chez elles et celles qui ne s’en sortaient pas avec la découverte des outils ad hoc qui faisaient aussi leur apparition, ce ne fut pour personne une sinécure.
Dans un sondage du magazine L’Express paru sur LinkedIn, à la question « Quel pourcentage de managers se déclarent sujets à de l’anxiété, notamment à cause du télétravail ? 71 % des managers se déclarent, en partie pour ces raisons, sujets à de l’anxiété »1.
De plus, selon les types de management, notamment ceux très orientés sur le contrôle, la tâche a été plus ou moins facile. Mais comme le signifie le terme chinois qui décrit le terme « crise – 危机», à la fois danger (Wei- 危) et opportunité (Ji- 机), certains l’ont pris comme cela pour réorienter leur manière de «savoir-faire managérial» vers un mode plus «savoir-être manageur». J’y reviendrai.
Et lorsque la crise covid semblait s’estomper et faire renaître des espoirs de retrouver un mode de vie au travail plus serein, une guerre est déclarée aux portes de l’Europe, via l’Ukraine et l’assaut russe… entraînant à sa suite une crise énergétique et de plus grandes insécurités qui perdurent toujours à ce jour. Et je n’ose évoquer la tension insoutenable au Moyen-Orient, les conflits toujours ouverts de par le monde… et les millions d’êtres sensibles en proie à la violence, à l’insécurité, à la famine, etc. Dans un monde interconnecté, tout a un impact sur tout.
Et à cet environnement, vient aussi s’ajouter un bon nombre d’autres facteurs parmi lesquels le développement exponentiel de l’intelligence artificielle qui réinterroge l’intelligence humaine2, le laps de temps réduit entre les nouvelles générations (on ne compte plus les lettres de l’alphabet pour les définir – X, Y… Z ?3), la question du genre et du wokisme, les fake news, qui s’invitent bien entendu également en entreprise : ce qui fait dire à la journaliste Claire Padych « qu’un chef cumule parfois vingt jobs en un »4.
On pourrait affirmer avec l’écrivain Paulo Coelho « … au moment où j’ai réussi à trouver toutes les réponses, toutes les questions ont changé »5. Constat auquel Ernest Hemingway aurait pu répondre : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas de signalisation »6.
Devons-nous pour autant nous résigner ? Aucunement. Parmi les bonnes nouvelles, car il y en a, nous pouvons également convenir, avec le chantre de la résilience psychologique, l’éthologue Boris Cyrulnik qu’ « on peut découvrir en soi, et autour de soi, les moyens qui permettent de revenir à la vie et d’aller de l’avant tout en gardant la mémoire de sa blessure »7.
Et, plus que jamais, comme le mentionne Frédéric Ooms8 : « Être entrepreneur exige des capacités cognitives particulières pour penser et agir face à l’incertitude ».
Ainsi, la bonne nouvelle par-dessus tout est qu’en intégrant dans sa vie manageuriale/entrepreneuriale une bonne dose de mindfulness et de méditation de pleine conscience, cela ne va pas agir comme une baguette magique, mais, avec de l’entraînement, une auto-discipline empreinte de compassion, il existe des possibilités de préserver sa santé mentale et d’échapper au mal qui ronge le plus le milieu : le burn out.
Pour cela, il est nécessaire de passer outre certains préjugés des deux côtés.
D’une part du domaine de la mindfulness – Méditation de pleine conscience qui reste souvent figée sur le point qu’il faut pratiquer sans objectifs, voire seulement éventuellement avec une intention ouverte pour ne pas pervertir à la base les principes opérant dans le processus.
C’est pleinement compréhensible quand on s’intègre dans la logique même de la pratique. Cependant, il en faut plus pour convaincre le monde managerial/entrepreneurial qui est préprogrammé aux objectifs et résultats… chiffrés si possible. Et qui comprend un nombre important d’ingénieurs formatés également dans cette perspective des choses.
Qui plus est comme les deux domaines sont emplis de préjugés, il est temps d’en lever au moins quelques-uns des principaux qui me sont remontés. J’en développe de nombreux dans l’abécédaire qui suit, en voici toutefois les principaux :
– La méditation fait l’apologie de la lenteur, et ce n’est pas compatible avec le monde de l’entreprise. On a souvent l’image d’Épinal du moine zen en lotus sur son rocher qui attend avec patience son disciple. Cette image n’est même pas 1% du sommet de l’iceberg de la Mindfulness. Je tenterai de le démontrer dans la suite.
– La méditation risque de m’affaiblir alors que j’ai besoin d’être fort pour être performant dans mes fonctions. Là encore, d’où vient cette idée ? Au contraire, de grands méditants tels le moine zen Thich Nhat Hanh, pour ne citer que lui, montrent que la force et le courage lui collent au cœur et au corps9.
– La méditation s’est développée au sein des monastères et s’adresse à des personnes en retrait de la société. Même la MBSR, avec ses méditations laïcisées, s’est intégrée dans le milieu du soin (care) et de l’hôpital, eux aussi domaines bien particuliers de l’économie sociale, des domaines inadaptés aux cycles concurrentiels des entreprises. Ceci est en partie vrai, mais repose sur une vue tronquée des choses. Il est erroné de croire que les monastères et autres lieux sont coupés des cycles de la vie. Même les hôpitaux sont soumis – on pourrait dire malheureusement – à des contingences d’économie concurrentielle.
– La méditation vient d’Extrême-Orient et n’est pas adaptée à nos références de vie occidentales. C’était en partie vrai. En tout cas au début. Cependant, grâce à de nombreux chercheurs et à l’évolution des neurosciences, on constate qu’un être humain… où qu’il habite, reste constitué de la même façon. Et que si on extrait la substantifique moelle des process méditatifs (de mindfulness pour être plus précis – il existe tellement de méditations différentes), il est avéré que les bienfaits sont transposables à tout être humain10. Qui plus est, lorsque l’on va plonger dans nos sources philosophiques occidentales11, notamment via les Stoïciens, on se rend compte des liens avérés entre leurs stances et ce qui sous-tend la méditation mindfulness.
– La plupart des expériences en entreprise ont lieu dans le monde anglophone, où les notions de réussite et d’échec sont complètement différentes du francophone. C’est un fait. Cependant, même si avec un certain humour la première approche mindfulness d’un manager soit de tomber sur le livre « Essaie encore, échoue encore, échoue mieux » de Pema Chödrön… il ne faut pas s’en tenir au titre. Au demeurant, il s’agit d’un ouvrage très éclairant à retrouver en bibliographie. Remarquons que l’approche des grands auteurs de méditation est souvent audacieuse, voire provocatrice. Ceci est plutôt de bon augure pour les managers qui se doivent d’innover, de sortir du cadre pour en créer de nouveaux ou investir dans de nouveaux espaces ouverts, plus spacieux. Nous ne sommes pas enfermés avec la méditation mindfulness dans des dogmes et/ou des préjugés. Le domaine est d’ailleurs pleinement investi et heureux des recherches scientifiques qui valident leurs process.
Nous sommes certainement à l’aube de l’introduction de la mindfulness en entreprise en francophonie. Des initiatives heureuses existent déjà et cela sera abordé bien entendu. Il nous appartient de poursuivre…
Notes
1. Voir l’article en ligne
2. Voir l’article en ligne
3. Voir notamment la vidéo de Clément Bergon : Générations X, Y et Z : Quelles Différences au Travail ?
4. Voir l’article en ligne
5. Citation extraite de « Maktub » de Paulo Coelho
6. Citation extraite de « L’adieu aux armes » de Ernest Hemingway
7. Citation extraite de « De chair et d’âme » de Boris Cyrulnik
8. Frédéric Ooms est Chargé de cours en innovation et entrepreneuriat à l’école de gestion HEC Liège, à l’université de Liège – via compte « cerveaupsycho » sur Instagram.
9. Thich Nhat Hanh est affectueusement et respectueusement dénommé « Thây » dans la sangha « Village des Pruniers » qu’il a fondé. Voir sa biographie résumée sur leur site
10. Voir notamment cet article bien documenté
11. Voir notamment cet article d’Aleteia ou encore cet article du « Point », ou encore les livres de Pierre Hadot ou de Xavier Pavie.
